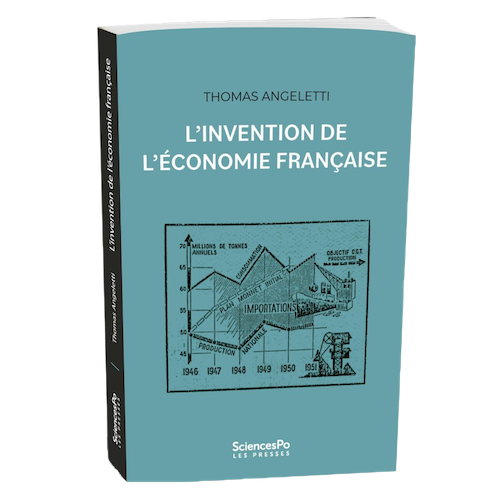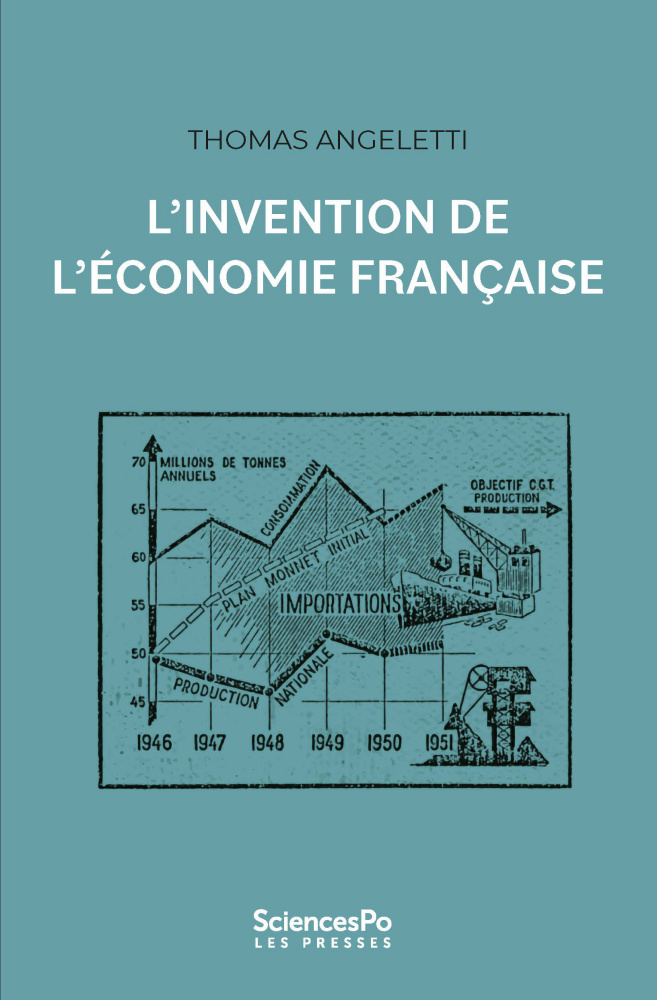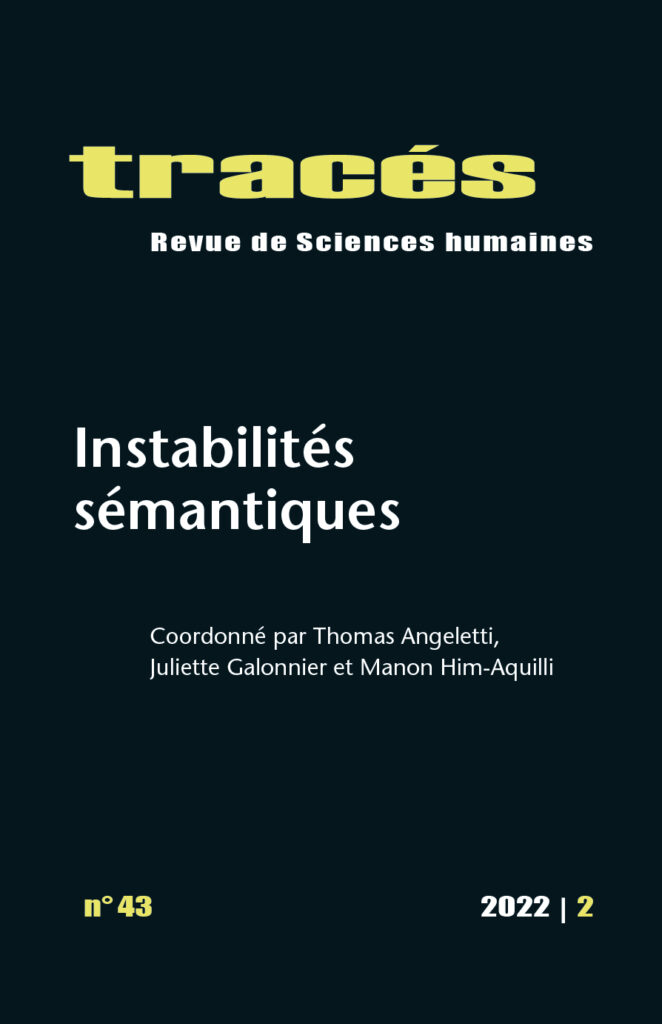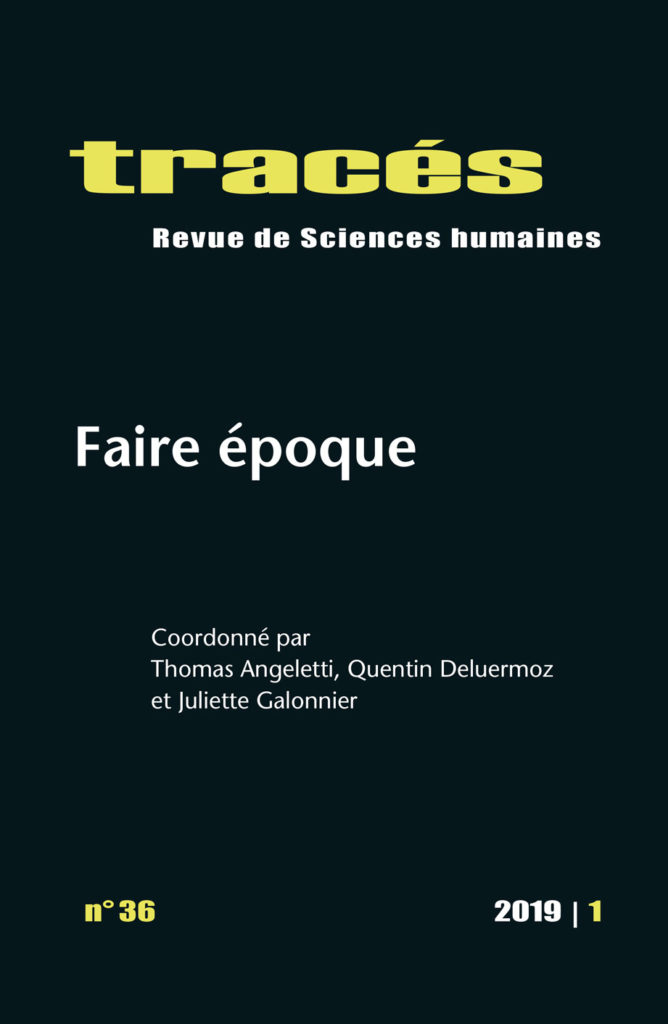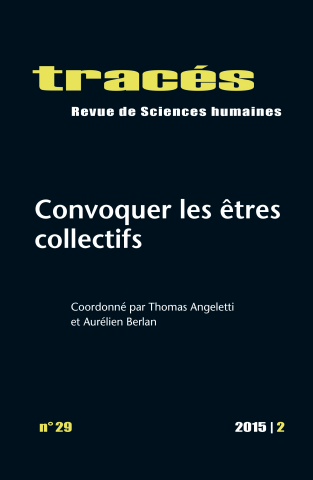Présentation de l’ouvrage sur le site éditions de l’EHESS.
Thomas Angeletti, Vincent-Arnaud Chappe, dir., Les modes de présence du droit, Paris, EHESS, collection Raisons Pratiques, 2024.
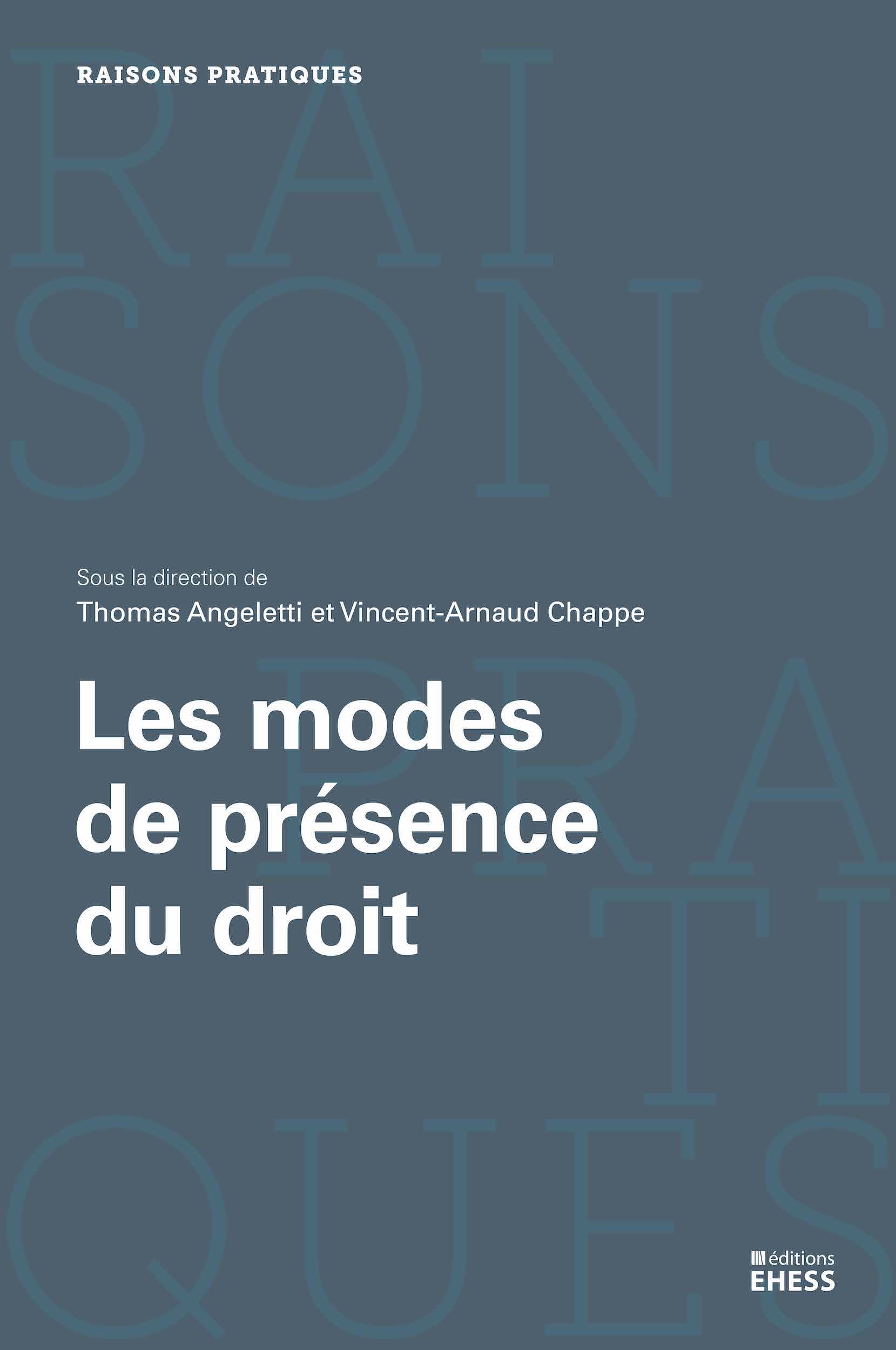
Les sciences sociales du droit sont prises en tenaille entre posture de dévoilement – révéler ce qu’il y a « derrière » le droit – et évaluation inquiète des évolutions contemporaines de l’institution juridique. Ces deux regards, bien qu’opposés en apparence, se rejoignent dans l’idéalisation de ce qui serait un droit pur, entier et non entaché de motifs et raisons externes. Ce faisant, il reste encore à produire un cadre apte à saisir le droit dans son caractère foncièrement hybride et impur. Puisant dans les sociologies d’inspiration pragmatique, ce volume plaide pour une re-description réaliste du droit et de ses différents modes de présence.
Il rassemble une série de contributions et traductions théoriques et empiriques, qui proposent une vision complexe des modes de présence du droit, c’est-à-dire des façons dont il fait saillance dans nos sociétés. Le droit n’y est jamais saisi comme une évidence ou comme un simple révélateur de mutations et rapports sociaux qui l’engloberaient. Ces contributions ont pour point commun de montrer comment les acteur·ices du monde social font avec et face au droit, jusqu’à mettre à l’épreuve la réalité même de l’institution juridique et ses frontières. Elles ouvrent ainsi la voie à une conception renouvelée de la norme juridique, libérée des regards nostalgiques et essentialisants à propos de sa véritable nature.
Sommaire
Présentation – 9
Thomas Angeletti et Vincent-Arnaud Chappe
Pour une sociologie des modes de présence du droit – 17
Pratiques du droit
Michael W. McCann
Mobilisation juridique et lutte politique – 63
Emilia Schijman
Habiter, posséder, prendre soin : des façons de faire droit – 109
Jean-Marc Weller
Pouvoir réglementaire et discrétionnarité. Perspectives pragmatique et praxéologique de la règle du droit – 131
Problèmes du droit
Hyo Yoon Kang
La matérialité du droit. Entre matières concrètes et formes abstraites, ou comment la matière devient matérielle – 159
Janine Barbot et Nicolas Dodier
L’approfondissement sociologique des problèmes du droit. Le cas des victimes au procès pénal – 191
Milena Jakšić
Les esprits à la Cour. Contraintes spirituelles et stratégie militaire dans le procès de Dominic Ongwen – 217
Frontières du droit
Brian Z. Tamahana
Pour une conception non essentialiste du pluralisme juridique – 245
Pauline Barraud de Lagerie
L’ « enceinte du droit » à l’épreuve d’un contentieux stratégique. L’affaire Total Climat – 279
Fabian Muniesa
Délire de droit et souveraineté radicale – 321